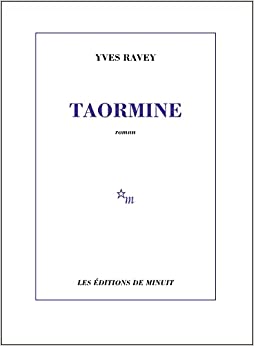Avertissement : si vous êtes une personne sensible, ne lisez pas ce livre. C’est assez violent à lire, puisqu’il s’agit de décider comment éliminer une partie de la population, considérée comme une charge pour la société.
Avertissement : si vous êtes une personne sensible, ne lisez pas ce livre. C’est assez violent à lire, puisqu’il s’agit de décider comment éliminer une partie de la population, considérée comme une charge pour la société.
Suède. Années 1970. Des experts sont réunis pour un colloque sur « La Phase terminale de l’être humain ». Le pays est en crise, les fonctionnaires suédois cherchent à faire des économies, et comme dans beaucoup de pays, cela commence par les personnages âgées, qui sont considérés comme des poids morts pour la société : beaucoup de charges et pas beaucoup d’apports. Le problème tend à s’amplifier puisque les personnes âgées ont une meilleure santé, suite au programme de santé, et vivent donc plus longtemps.
Le concept est déjà acté par les experts du congrès. Le but du congrès est uniquement de déterminer la manière de faire accepter le concept à une société qui n’est pas prête.
Il nous faut suivre l’autre voie : celle de la mise en condition psychologique des personnes âgées, afin qu’elles décident elles-mêmes d’en finir. De façon directe et motivée par ce que nous pouvons appeler l’esprit de sacrifice pour le bien commun. Il ne s’agit de rien moins que d’une nouvelle façon de penser, d’une nouvelle institution sociale basée sur la volonté populaire. Sur ce plan, il y a également de grosses économies à réaliser. [p. 61]
On choisit délibérément les personnes âgées, car leur groupe est plus important que par exemple celui des malades.
On pourra naturellement toujours objecter que les économies réalisées grâce à ce processus d’élimination seront marginales, étant donné que le nombre de malades est limité, comme en ce qui concerne la dialyse. Mais ce n’est là qu’un exemple, un cas type dans lequel la société peut dès maintenant mettre un terme à des dépenses médicales non rentables motivées par une vague philosophie s’appuyant sur le caractère intangible de la vie. […] C’est pourquoi il convient, d’après moi, de procéder avec prudence et de façon systématique. Il faut délimiter des groupes marginaux les uns après les autres, tant que l’opinion publique ne sera pas mûre pour la solution d’ensemble que Persson a esquissée, à savoir amener l’être humain, de façon générale, à s’habituer à l’idée d’une vie plus brève, à une espérance de vie se rapprochant plus de celle jadis considérée comme normale. [p. 53]
La personne âgée est vue uniquement comme un problème économique
Pensez un peu aux soixante milliards d’impôts consacrés chaque année aux soins de longue durée et aux retraites. Ils permettraient de sauver nos exportations et l’emploi. [p. 67]
Je pense que vous avez saisi l’idée. L’ouvrage est construit selon le programme du colloque, et le texte prend la forme des minutes du congrès. Deux jours. Le premier jour, le matin, le modérateur présente le problème et la solution envisagée, puis arrivent les interventions des experts qui s’expriment pour cette solution, et sur la manière dont on pourrait la mettre en place. Ils justifient leurs positions en donnant un contexte historique, philosophique et théologique (oui oui il y a des religieux qui sont pour ce genre d’idées). L’après-midi du premier jour parle un seul participant, le dissident, celui qui rappelle que la mort n’est pas un thème de société, mais un thème individuel :
Je voudrais le faire en reprenant le problème de la mort par le petit bout de la lorgnette, à savoir celui de l’individu. [p. 133]
Il rappelle également que l’individu ne doit pas seulement être vu comme un rouage de la société ou comme un moyen économique, mais bien comme un être humain, dont l’humanité doit être considérée comme au-dessus de tout :
Pour en revenir à la mort à Pompéi, finalement, il est certain que la mort à l’âge de quarante ans n’est pas quelque chose à regretter. Mais il se trouve que l’économie estime que nous sommes allées trop long dans l’autre sens, nous qui mourons à quatre-vingts ans. Or, il semble bien que les hommes de Pompéi vivaient intensément, avant de mourir sans avoir pu vivre. On nous permet simplement d’exister. Tout d’abord en tant que facteurs de production. Puis on nous tolère, pour ainsi dire, quand nous sommes vieux – pour l’instant tout du moins. On nous concède, il est vrai, certains loisirs, mais alors nous avons simplement la force de faire un petit tour en voiture, en bateau, de poser un toit, de poser un filet – ou bien de poser nos bagages pour de bon. Nous n’avons pas la force de vivre. [p. 136]
Cette partie soulage un peu le lecteur, éprouvé par la première partie. On se dit que voilà enfin une personne avec un peu de sens moral, et d’empathie, et pas un expert qui voit uniquement le problème comptable que peut poser le vieillissement d’une société. C’est une pause, qui rend les discours du deuxième jour encore plus horrible : que faire des corps une fois les personnes âgées éliminées.
Le texte a été publié en 1978 en Suède, et, nous dit la quatrième de couverture, a fait scandale. Franchement, je pense que son potentiel de scandale est intact aujourd’hui. Comme vous l’avez compris par les extraits, je l’espère, c’est une langue très sèche, des discours d’experts pleins de culture et d’idées, qui manque de réels moments de vie. Tout le monde s’écoute parler, sans s’écouter puisque chacun a déjà un avis très construit. En plus, ici, il y a seulement un avis contradictoire, la majorité partage le même avis. Je trouve que cela ressemble beaucoup aux débats d’experts que l’on peut entendre partout (je ne mets pas dans le même sac, les personnes qui ont des discours opposés, mais qui ne justifient pas leurs opinions). Il n’y a pas de débat puisqu’il y a homogénéité des opinions. La personne avec un avis contradictoire est invitée comme un prétexte, plutôt que comme une personne qui pourrait permettre de construire une solution légèrement différente.
La solution est construite préalablement par ces experts qui sont censés représenter l’élite de la société, et qui pensent œuvrer pour celle-ci. La société n’est vue que comme une masse à influencer, plus exactement à manipuler, pour que la solution soit vue comme une solution construite par elle-même. Pour moi, c’est comme si on considérait la masse comme un problème général.
C’est admirable d’avoir su voir cela dès 1979. Wijkmark est mort en 2020, mais a pu préfacer en mai l’ouvrage. Il fait un parallèle entre son roman et la décision de la Suède de favoriser l’immunité de troupeau (et pour le coup, le mot est tellement bien choisi) dans le cadre de la pandémie que nous vivons. Il dénonce dans cette postface une décision de « bureaucrates. Bureaucrates de la santé, bureaucrates de la planification, bureaucrates de la logistique et même bureaucrates des questions éthiques ».
En conclusion, je ne peux pas vous dire que j’ai aimé cette lecture, et je ne peux donc pas vous dire lisez ce livre, vous allez passer un excellent moment. Cela a été surtout un choc de voir quelqu’un mettre en mots et en scènes les impressions que j’avais sur la direction que prend notre société.
Références
La mort moderne de Carl-Henning WIJKMARK – traduit du suédois par Philippe Bouquet (Rivages, 2020)
Un siècle de littérature européenne – Année 1978